L’état civil aux Antilles
Aux origines : un édit royal pour préserver la mémoire
En juin 1776, un édit du roi vient bouleverser la gestion des archives dans les colonies françaises.
Il ordonne non seulement la tenue d’un registre paroissial supplémentaire à envoyer au Dépôt des Papiers Publics des Colonies (DPPC) à Versailles, déjà exigé depuis 1763, mais impose aussi la recopie et la transmission des registres antérieurs.
Désormais, les notaires doivent également établir une double minute de leurs actes (sauf inventaires après décès).
C’est grâce à cet édit que la France conserve aujourd’hui une partie des archives anciennes des Antilles françaises, contrairement à celles des colonies anglaises ou espagnoles, souvent perdues.
Application inégale entre les îles
L’édit de 1776 n’a pas été appliqué avec la même rigueur dans toutes les îles.
En Guadeloupe, les registres anciens ont été systématiquement recopiés, y compris le plus ancien connu, celui de Capesterre daté de 1639.
En revanche, en Martinique, la conservation fut plus chaotique : beaucoup de registres envoyés à Versailles ne commencent qu’en 1763.
Néanmoins, certains registres plus anciens, encore conservés localement, ont été microfilmés mais pas toujours transmis aux archives nationales (CAOM ou CARAN).
Il faut donc garder en tête que les actes antérieurs à 1777 (et parfois au-delà) sont des copies tardives, parfois fautives, établies par des copistes extérieurs, peu familiers des familles locales et confrontés à des écritures difficiles à déchiffrer.
L’édit de 1776 n’a pas été appliqué avec la même rigueur dans toutes les îles.
Une orthographe mouvante et des noms déformés
Les curés rédacteurs, venus de diverses régions de France, orthographiaient les noms à l’oreille, selon leur propre accent ou compréhension.
Les noms de famille et de lieux furent donc souvent déformés, une difficulté majeure pour les généalogistes antillais d’aujourd’hui.
Il est courant qu’un même individu apparaisse sous plusieurs variantes orthographiques dans les archives : Désiré/Désiret, Laforest/Laforêt, Nardy/Nardal, etc.
Registres des libres et oubli des esclaves
Les registres envoyés à Versailles ne concernaient que les personnes libres, qu’elles soient blanches, noires ou mulâtres.
Les registres d’esclaves, tenus séparément, n’ont pas été transmis.
Quelques rares exemplaires, datant du XIXe siècle, ont néanmoins été retrouvés en Guadeloupe et en Martinique
Ces documents constituent aujourd’hui des sources précieuses pour retracer la filiation d’anciens esclaves affranchis.
Baptêmes, naissances et précautions généalogiques
Aux Antilles, il n’était pas rare qu’un baptême ait lieu plusieurs mois, voire plusieurs années après la naissance.
De plus, la date de naissance était parfois indiquée de manière très vague, voire omise.
Les chercheurs doivent donc distinguer soigneusement date de naissance et date de baptême, et mentionner les deux lorsqu’ils établissent une généalogie.
Les tables décennales : un outil essentiel
Les registres transmis en France ont donné lieu à la création de tables décennales, à partir de la Révolution, listant par ordre alphabétique les naissances, mariages et décès.
Ces tables demeurent le point de départ de toute recherche généalogique.
Mais prudence : les numéros de folio ou d’acte indiqués ne correspondent pas toujours aux microfilms, certains ayant été mal paginés ou numérisés plusieurs fois.
Les noms à particule doivent être recherchés à la lettre D (de, du, des) mais aussi à la première lettre du patronyme.
Des fiches alphabétiques à l’état civil moderne
Entre 1831 et 1849 (Guadeloupe), 1846 (Martinique) et 1840 (Saintes, Marie-Galante, Guyane), furent établis des blocs fiches alphabétiques recensant tous les actes : naissances, mariages, décès, reconnaissances et affranchissements.
Ces fiches, consultables sur microfilm au CAOM, couvrent toutes les communes des colonies.
La Guadeloupe et la Guyane passent à l’état civil en 1794, tandis que la Martinique, sous domination anglaise à cette époque, conserve l’organisation paroissiale jusqu’à son retour à la France.
La numérisation : un accès encore partiel
Depuis les années 2010, les départements d’outre-mer ont entamé la numérisation de leurs archives, incluant registres paroissiaux, tables décennales et actes d’état civil.
Une grande partie est désormais accessible en ligne, mais certaines archives restent consultables uniquement sur place, notamment les registres les plus fragiles

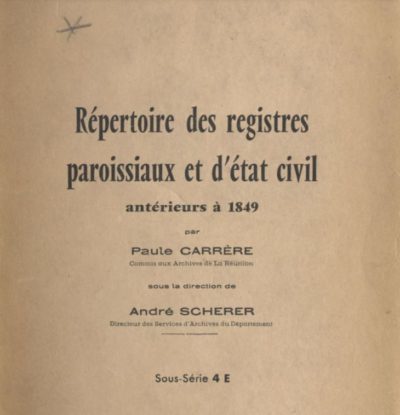


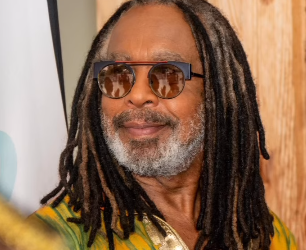

0 commentaires